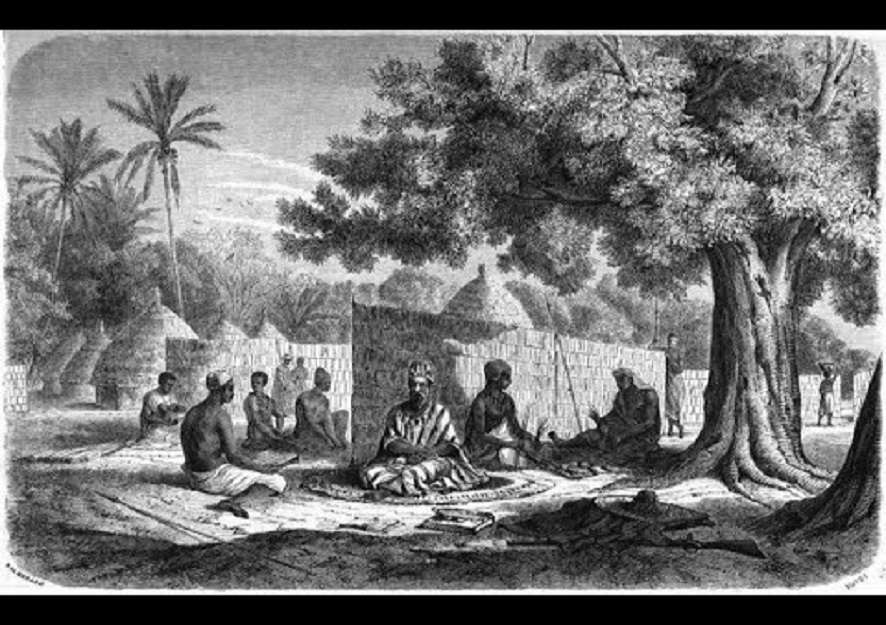Résumé de la thèse intitulée Le Takrur : des origines à la conquête par le Mali (VIème ? – XIIIème siècle), doctorat de 3ème cycle présenté par Ba Abdourahmane sous la direction du Pr J. Devisse, Université Paris Jussieu, UFR de Géographie, Histoire et Sciences de la société, 1984, 261p.
Cette thèse qui se veut une « entreprise de sauvetage du Takrur » (page 13), suivant les recommandations du Professeur Moraes Farias, se présente comme un voyage dans l’histoire de l’Afrique médiévale ou plutôt de l’Afrique occidentale médiévale pour questionner les sources orales et écrites existant en la matière. Elle tente, non seulement de percer une partie du mystère sur une période peu connue de cette contrée, mais aussi et surtout de déconstruire certaines idéologies véhiculées par des chercheurs dont l’objectivité est mise à mal dès qu’il s’agit de se pencher sur l’histoire africaine. Pour atteindre ces objectifs, Ba organise son travail autour de cinq (5) parties.
La première partie se penche sur une tentative de récréation géographique du Takrur en en traçant les limites qui se sont modifiées au gré des vicissitudes de l’histoire d’une région assez mouvementée, de la fortune des princes maures et sénégambiens ayant contrôlé la zone. Ba commence par camper la région du Fuuta Toro, considérée comme la continuité du Takrur. Cette région aride irriguée par le fleuve Sénégal est, selon l’auteur, le berceau d’une civilisation née des opportunités que la zone humide des pourtours du fleuve offre pour l’agriculture. Faisant partie du Sénégal actuel, elle s’étend sur sept régions et comprend une large bande située à cheval entre le désert et le climat soudanais.
Si l’histoire de cette zone est bien connue dans la période allant du 16ème au 19ème siècle, elle l’est très peu pour celle datant d’avant, vu la rareté des informations la concernant.
Pour délimiter le Takrur qui correspond globalement à cette région du Fuuta Toro, à son apogée, Ba insiste sur la nécessité de se fonder beaucoup plus sur les dynasties qui en ont pris le contrôle au cours de l’histoire que de s’en tenir à des limites territoriales physiquement marquées.
La première dynastie sur laquelle il s’appuie pour parler du Takrur comme entité étatique, constitue les Jaa Ogo qui seraient venus, selon les récits du traditionniste Siré A. Sow, de la péninsule du Sinaï (le mont Tor) avant de passer par Tagant pour arriver dans ce qu’est le Fuuta Toro actuel.
Les limites du royaume, du temps des Jaa Ogo comprendraient les bords du fleuve Sénégal, le Tagant et une partie de l’actuel Fuuta Toro en ayant une extension vers le Nord. Mais, pour C. M. Kamara, les Jaa Ogo n’auraient nullement une origine égyptienne et seraient tout simplement venus du Dyolof. Leur cercle de commandement engloberait la zone comprise entre le Ferlo et la vallée du Sénégal, y compris le Namandiru. Cependant, les sources orales Wolof contestent l’appartenance du Namandiru au Takrur. Outre Sow et Kamara, une version Soninké fait du Takrur du temps des Jaa Ogo un État faisant frontière avec le territoire des Baccili.
Ba, après une critique de ces diverses versions, conclut la question sur les limites du Takrur des Jaa Ogo en substituant à l’aspect territorial l’aspect humain, le peuplement. Aussi note-il que le Takrur des Jaa Ogo semble être une zone ayant abrité divers groupes ethniques : Walof, Sereer, Haal pular et peut-être Soninké.
Au Takrur des Jaa Ogo, succède celui des Manna (deuxième dynastie régnante). A cette époque, le territoire qui semble inconnu des auteurs arabes au moment des premiers contacts transsahariens, l’est de plus en plus par la suite parce que nombre d’entre eux, dont Al-Bakri et Al-Idrissi en font une description pour situer sa position géographique et faire état de son rapport avec ses voisins comme Ghana. Ainsi, Al-Bakri et d’autres auteurs soutiennent que le Takrur occupe, à l’époque, les environs de Podor, alors qu’Al-Idrissi et Ibn Said le réduisent tout simplement au statut de capitale d’un pays prospère. Mais, si Al-Idrissi le localise près de Ghana et du Galaam, Ibn Said le situe entre deux rives du Nil (pris ici comme n’importe quel fleuve que Ba s’efforce d’identifier au Sénégal).
Tout compte fait, les sources parlent du Takrur des Manna comme d’un État dont la puissance et le rayonnement lui permettent de rivaliser avec l’empire du Ghana autant sur le plan économique que sur les plans politique et idéologique. Cette rivalité s’exprime à travers l’opposition des deux Etats en ce qui concerne le rôle stratégique que chacun veut avoir dans le contrôle de la région. Il s’ensuit une domination de Ghana dans le commerce tandis que le Takrur marque son hégémonie dans le domaine de l’exploitation de l’or. Cette rivalité s’exprime également à travers l’opposition des deux Etats en termes de pratiques religieuses (le Ghana animiste s’opposant au Takrur islamisé) et sur le désir de chacun des deux Etats de contrôler le royaume voisin de Silla entre les XIème et XIIème siècles.
Ainsi, à l’époque de la dynastie Manna, surtout au XIIème siècle, le Takrur se trouve être au milieu d’enjeux régionaux et sa puissance lui permet d’étendre ses frontières en soumettant la ville aurifère de Yaresna (ou Barisa). Aussi, aidée par son alliance avec les Almoravides, il étend sa domination sur les salines d’Awlil qui ravitaillent toute la région en sel et sur Sangama dont le contrôle semble, selon les sources, lui avoir permis d’avoir la mainmise sur une large zone allant du fleuve Sénégal à l’Océan Atlantique. Le Takrur connaît une extension tel qu’il devient frontalier du N’Galam.
Pour Ba, des différentes informations, il faut retenir la difficulté d’identifier les frontières du Takrur du temps des Manna comme ce fut le cas du temps des Jaa Ogo. On peut tout de même trouver des éléments qui font l’unanimité chez les auteurs dont les travaux ont été consultés par l’historien : la situation du Takrur sur les deux rives d’un fleuve (le fleuve Sénégal apparemment) ; le caractère urbain du site qui pourrait avoir eu ou non des murailles le protégeant ; on y menait une vie centrée sur le commerce avec la présence d’étrangers. Toutes ces informations incitent, de l’avis de l’auteur, à des fouilles archéologiques sur la vallée du Sénégal pour affiner les connaissances sur ce territoire autour duquel naît un mythe, dès lors qu’il passe sous domination Mandingue à la chute des Manna.
En effet, l’empire du Mali s’étendant, soumet le Takrur dont il en fait une région au XIVème siècle. Alors, une confusion s’installe, entretenue par plusieurs chroniqueurs arabes qui, au lieu de le voir comme un État avec ses différents sites, le confondent au Mandingue ou encore à toute la zone du Soudan occidentale. Parmi les auteurs de cette erreur, se retrouvent de grands noms comme le célèbre Alumri, témoin, entre autres, du pèlerinage de Mansa Musa et de la coopération entre l’Egypte et la zone soudanaise. Il fait de Mansa Musa, le roi du Takrur. On note également l’un des chroniqueurs arabes les plus connus, Ibn Khaldoun qui intègre le Takrur (dont il fait une simple ville), Silla et Ghana au Mali, mais localise curieusement les habitants du Takrur à l’Est du Kaw Kaw (que l’historien W. D. Cooley trouve être le Niger). Quant à Al-Makrizi, le Takrur est tout simplement le Mali, voire, par extension, le Soudan occidental dans son entièreté. Enfin, Al-Kalkashandi, s’inspirant de ses prédécesseurs, étend les limites du Takrur aux frontières de Borno et en fait la capitale du Mali.
Cependant, cette confusion sur l’identité du Takrur, devenu partie intégrante de l’empire du Mali, n’est pas entretenue que par les chroniqueurs arabes ; des intellectuels du Soudan occidental tombent dans la même erreur à force de suivre sans regard critique les premiers. Parmi eux, figurent en bonne place ceux de Jenne (Djéné) et Tombuctu. Tel est le cas d’Ahmad Baba qui se réfère au savant et juriste musulman venant d’Algérie, Al-Maghili, dont il a redigé d’ailleurs une biographie.
Cette confusion est entretenue jusqu’en Egypte où elle trouve illustration dans un manuscrit de la Bibliothèque nationale du Caire qui constitue une lettre de Djalal ad-Din as Suyuti as Shafait à ceux qu’il qualifie de « Sultans du Tékrur en général » faisant ainsi de cet État toute une région composée de divers « sultanats ».
Ba avance de nombreuses hypothèses sur ce qui est à l’origine de cette méprise sur l’identité du Takrur ayant provoqué sa mythification. Il soutient qu’au nombre de ces hypothèses, figure l’inimitié des chefs des Etats situés au nord du fleuve Sénégal à l’égard de Ghana, de Mali et de Songhai restés longtemps animistes par rapport au Takrur qui s’islamise et se rapproche ainsi d’eux sur le plan idéologique. On verrait dans cette hypothèse un sous-entendu selon lequel, les sources arabes venant de ce nord auraient privilégié le Takrur islamique sur les autres Etats restés attachés aux religions traditionnelles. Une autre hypothèse suppose que cette confusion aurait un lien avec la dissémination des Toucouleurs et des Peuls musulmans à travers le Soudan occidental. Pour Ba, cette situation de cacophonie pourrait venir du fait qu’au Hijaz (région à laquelle appartient la Mecque), l’appellation « Takruri » (traduit comme « ceux qui sont originaires du Takrur ») s’était imposée pour désigner les pèlerins venant, par groupes, de l’Afrique occidentale. Il a fallu trouver donc un dénominateur commun pour les désigner, par commodité, pour faciliter l’identification sans avoir user des termes spécifiques pour les pèlerins de chaque État ou entité de la région. Quoi donc de plus naturel que de choisir le nom de L’État le plus familier !
Enfin, la dernière hypothèse soutient que la généralisation de l’appellation Takrur à toute la région serait due au souvenir de la richesse et du rayonnement de cet État qui a réussi à éclipser le Ghana et à s’imposer à la mémoire des acteurs du commerce transsaharien à un moment où le Mali n’avait pas encore connu l’éclat qui a été le sien après l’avènement de Soundjata Keita.
Après la première partie concernant la discussion des sources sur la localisation et l’étendue du Takrur durant la période qu’il a choisie de couvrir dans son étude (VIème -XIIIème siècle), Ba procède à une analyse du peuple et du peuplement de l’État. Pour ce faire, il entame sa démarche par une mise au point dans laquelle il s’efforce de lever une équivoque entretenue par des chercheurs, surtout occidentaux, dont la démarche est inspirée du « diffusionnisme », un paradigme scientifique hérité de Hegel, aux méthodes teintées de préjugés qui conçoivent les mouvements de population en Afrique comme des déferlements de marrées humaines du Nord au Sud, d’Est en Ouest. Cette conception dont il désigne Michael Growder comme l’un des tenants serait due, selon Ba, à un mauvais traitement scientifique des légendes et mythes locaux qui mettent en avant des récits de mouvements de population dans le peuplement de l’Afrique.
Or si cette insistance sur des vagues de migrations dans les récits des chroniqueurs africains s’explique, d’un point de vue local, par la nécessité pour les peuples qui en sont les producteurs de se rattacher à des origines les valorisant (au Prophète Muhammed et aux terres de l’islam pour les peuples islamisés de Sénégambie par exemple), la doctrine coloniale en fait un outil de justification de sa mission de mise en ordre d’un espace toujours caractérisé par l’instabilité, le désordre et l’inconscience. Cette attitude à laquelle il appelle ceux qui travaillent sur l’histoire à se méfier et qui est, selon lui, l’impact de la pensée de Hegel sur la recherche scientifique des XIXème et XXème siècles, affecte malheureusement à la fois les africanistes et les africains eux-mêmes.
Ainsi, l’objectif affiché par Ba, dans cette partie, est une déconstruction de la théorie de l’invasion nomade en vogue dans les récits d’historiens occidentaux à travers ce qu’il appelle « le phénomène de calque » où l’on s’efforce à construire un antagonisme solide entre des nomades envahisseurs, vivant dans la précarité et des sédentaires stables et pourvus de ressources que les premiers (les nomades) envient et pillent dans un grand désordre violent.
Dès lors qu’il réfute cette méthode qui s’apparente à une forme de légitimation de la domination coloniale cherchant à civiliser une Afrique désorientée et anarchique, Ba peut s’atteler à l’examen du peuplement du Takrur qui apparait sous sa plume comme une zone de contact entre divers peuples dont les rapports conflictuels ou paisibles sont dictés, comme partout ailleurs, par les enjeux des alliances et des questions vitales liées à leurs activités et à leur idéologie. Ainsi, le Takrur, zone intermédiaire entre le Sahel et le Soudan met bien un lien entre nomades et sédentaires. Les nomades jouent même un important rôle dans le peuplement du Takrur, mais cette intervention ne prend pas la forme d’un antagonisme tel que décrit par les historiens occidentaux. Ici, on remarque plutôt des alliances entre nomades et sédentaires qui luttent ensemble contre d’autres nomades qui menacent leurs intérêts communs. Ainsi se réalise, par exemple, la lutte contre les nomades Goddala dans une synergie entre populations sédentaires et nomades pour éviter de perdre le contrôle de leur zone d’action. Aussi, les Trarza nomades ne s’attaquent pas qu’aux sédentaires du Waalo ou du Fuuta sénégalais. Ils s’en prennent aux tribus Brakna qui, comme eux, sont nomades.
Les conflits entre nomades et sédentaires sont ainsi liés à des questions stratégiques (politiques, économiques), les princes maures jouant aux entremetteurs dans le Fuuta et le Walo en fonction de leur intérêt plus qu’à une quelconque antinomie essentielle entre les deux groupes.
Dans un tel contexte où les rapports entre les populations sont fonction des questions stratégiques, il ne manque pas de se soulever la question de l’environnement dans lequel elles vivent, parce que sa nature et les activités qu’il autorise a forcément une incidence sur leur mode de vie et, de ce fait, sur leur façon de coexister. Aussi, Ba nous apprend-il que l’aridité qui s’installe au Sahara (entre 150 av. J.C. et le début du VIIIème siècle) chasse les populations qui y vivaient vers le Sud, dans les pourtours du fleuve Sénégal même si certains groupes restent en se convertissant au nomadisme.
Dès lors, le Takrur, dont cette zone proche du fleuve est le lit, fait figure d’eldorado, de terre d’asile. On pourra ainsi dire que la base du peuplement du Takrur se constitue par cette descente de populations sédentaires du sud mauritanien vers la vallée du Sénégal. Suivent cette migration de base, diverses réadaptations et modifications dans l’occupation de l’espace.
Mais il faut souligner que malgré ces informations qui semblent donner une vue claire sur le peuplement du Takrur, celui-ci fait l’objet de divergences entre les sources dont se sert l’auteur pour l’établir.
Ainsi, les Bafours ont pu être donnés comme faisant partie des plus anciens occupants du Takrur. Si certaines sources en font des noirs, des chercheurs aveuglés par la discrimination mettent en doute cette caractéristique, prenant pour alibi le mode de vie de ce peuple phéniciculteur maîtrisant les techniques d’irrigation, pratiquant l’élevage des chiens et des chevaux ; mode de vie que ne sauraient adopter, selon eux, des noirs. Un tel positionnement, remarque Ba, ne saurait être acceptable. Pour lui, la connaissance ne pouvant être l’apanage d’une race, la seule vérité qu’on puisse établir quant à l’origine des Bafours est qu’ils descendraient de l’Afrique du nord, rien ne pouvant préjuger de leur race.
D’autres sources font des Sereer les premiers à avoir habité le Takrur. Ce point de vue est soutenu par des découvertes faites dans des villages Sereer ainsi que les récits de ce peuple sur son origine, confirmés par la toponymie.
Ce questionnement sur les premiers occupants du Takrur fait surgir un autre relatif à l’identité des Jaa Ogo, connus comme étant la première dynastie régnante sur cet État. Seraient-ils ainsi des Sereer, des Galunkobe ou des Fadube ? De nombreuses hypothèses sont avancées, chacune avec ses forces et ses faiblesses.
Ainsi, pour M. Delafosse, les Jaa Ogo seraient des Pël (Peuls). Pour soutenir sa thèse, il se fonde sur le récit du chroniqueur S. A. Sow qui leur donne le patronyme Jaa (Dia). Cette thèse est reprise par plusieurs autres chercheurs sans vérification, à l’exception de F. Brigaud qui dit avoir cherché à prouver son authenticité à Matam. Mais Ba remet en cause sa solidité car, dit-il, on pourrait objecter que Delafosse se fie uniquement à Sow sans examen critique de son récit qui ne donne aucun gage de vérité. Il oppose alors au récit de Sow, l’information de B. Gangue, inspecteur de l’enseignement à Podor qui lui a confié que Jaa, au lieu d’être un patronyme, est un titre. Aussi, il avance comme argument pour contredire Delafosse le fait que les Peuls du Takrur étaient des nomades alors que les Jaa Ogo étaient des maîtres en métallurgie.
D’autres sources, comme le manuscrit de Gaden, soutiennent que les Jaa Ogo seraient plutôt des Sereer.
En outre, autant que pour l’appartenance ethnique des Jaa Ogo, on note une contradiction entre les sources sur leur culture, leur façon d’être : si Sow affirme qu’ils étaient évolués, d’autres auteurs comme Bokoum soutiennent qu’ils étaient plutôt primitifs, frôlant la sauvagerie.
Pour Ba, on pourrait conclure en partant de toutes ces hypothèses que les Jaa Ogo seraient un mélange de Faduba et de Galunkobe (terme employé par les Peuls pour désigner ceux qui ne parlent pas pular, les Sereer y compris). D’ailleurs, pour montrer qu’il n’y a rien d’étonnant que les Jaa Ogo aient été un mélange d’ethnies ayant formé le peuplement du Takrur, il soutient que l’État traditionnel africain plurinational n’a pas de problème et que c’est plutôt l’État moderne, parce qu’il a un substrat colonial, qui en possède, avec la pulsion de mort qui le caractérise et « tendant à nier et à écraser toute spécificité nationale » (p. 108).
En effet, dans le Takrur, les Sereer, dont la présence remonte à des temps très anciens, y cohabitent paisiblement avec les Lebu et les Subbalbe (un groupe socio-professionnel de pêcheurs). Si on s’attendait à ce que ces derniers qui sont des gens de caste soient mis au bas de l’échelle, dans le Takrur, ils jouissent d’énormes privilèges : ils sont considérés comme nobles, ont les meilleures terres, vu leur ancienneté dans l’occupation de l’espace, conformément à la règle qui y est de mise et qui stipule que la terre appartient à son premier occupant. Les subbalbe sont aussi respectés pour le savoir magico-religieux qu’on leur prête. Celui-ci leur permettrait, en effet, d’affronter le génie de l’eau. De ce fait, ils seraient maîtres du fleuve.
Quant aux Lebu, nombreuses sources les voient comme originaires d’Egypte sans qu’une date de leur migration de l’Est vers l’Ouest ne soit donnée. Toujours est-il que leur statut d’anciens occupants du Takrur est attesté par la toponymie de nombre de lieux qui longent le fleuve Sénégal. Certaines sources notent même que le mot Takrur serait une altération de l’expression Lebu « Dekku Tuur ».
Pour Ba, cette facilité de cohabitation de ces peuples tient à une proximité parentale, à des pactes d’entraide et à leur proximité culturelle : on note chez tous, par exemple, une similitude des génies présents dans la sphère magico-religieuse, des chants et de l’importance accordée à la lignée matrimoniale.
Pour ce qui est de la question Toucouleur dans le peuplement du Takrur, elle s’avère complexe, note Ba. Elle mobilise deux camps. Le premier, auquel appartient Delafosse, en fait non seulement un groupe homogène pur, mais aussi les premiers autochtones du Takrur à côté des Sereer et des Walof (appelés « Makzara », c’est-à-dire « la race noire » par Al-Idrissi, par opposition aux Peuls). Toujours selon ce camp, la domination des Toucouleurs s’étendrait jusqu’à la fin du IXème siècle[1] et l’arrivée de la première migration judéo-syrienne qui prendra le pouvoir pour deux siècles. Ce sont ces migrants qui seraient devenus l’ethnie Peul en adoptant la langue des Toucouleurs.
Pour Ba, cette version ne convainc pas parce qu’il estime qu’elle est fondée sur des préjugés : si l’on pense que les migrants ayant pris le pouvoir au Takrur pour deux siècles sont les Jaa Ogo, rien ne dit que ceux-ci sont des Peuls vu qu’il est difficile de croire que ces derniers se réclamant Haal pulaar (langue des Peuls) aient emprunté la langue d’un autre groupe ethnique. Dans le même sillage que Delafosse, C. A. Joop (Cheick Anta Diop) soutient que les Toucouleurs constituent un groupe homogène venu de la vallée du Nil et se fonde, pour argumenter sa thèse, sur des éléments linguistiques et ethnographiques. Mais Ba rejette à nouveau cet argument en soulignant que les mots du lexique avancés comme preuve de proximité entre les Toucouleurs et les peuples de la région de Nubie et d’Abyssinie sont courants dans cette zone et appartiennent aussi à des groupes ethniques sans liens présupposés avec les Toucouleurs.
Par ailleurs, dans ce camp, il a aussi été soutenu que les Toucouleurs et les Peuls sont deux groupes provenant d’une même ethnie, les Peuls : les toucouleurs seraient les Peuls sédentaires tandis que les Fulbés seraient les Peuls nomades. Ce qui n’est pas sûr, selon Ba. Pour lui, en effet, les Toucouleurs reconnaissent leur parenté avec les Fulbés mais ne reconnaissent pas en faire partie. Aussi trouve-t-on dans l’imaginaire toucouleur une peinture négative des Peuls qu’ils traitent d’ignorants. De leur côté, les Peuls aussi disent des Toucouleurs qu’ils sont des mendiants quand ils ont faim. Ba ajoute aussi que le mariage est rare entre Peuls et Toucouleurs. Ainsi, le groupe « Toucouleurs » se serait réellement constitué au XIXème siècle avec la colonisation française : le terme est alors en usage par les colons et le reste de la population sénégambienne pour désigner ceux qui se disent « Haal pulaar ». Toucouleur ne serait aussi que la forme francisée de Takruri.
Pour le second camp, il faudrait plutôt voir les Toucouleurs comme un groupe issu de peuples disparates. Pour étayer leur thèse, les tenants de ce camp partent des mots « Takrur ou Takruri ». Pour eux, en effet, le Takrur ou Takruri est l’ensemble des composantes nationales du Takrur d’une époque floue :
Sereer, Lebu, Walof, Soninke et même Peuls. L’apport maure serait venu s’y ajouter pour former le groupe les Haal pulaar. Il est même possible que Soninke, Seerer, Lebu, Walof et maures, à travers les métissages biologiques et culturels aient donné naissance au groupe trans-ethnique que sont les Toucouleurs. L’unité entre ces peuples se serait faite tardivement, au XVIème siècle, moment où la puissance des Fulbe monte suite à l’affaiblissement de l’empire du Mali pour constituer le vaste empire Denyanke, alors qu’ils n’avaient formé auparavant que de petits Etats émiettés, s’étendant du fleuve Sénégal au Fuuta Djallon en passant par les régions aurifères du Haut Sénégal. Cette période correspond au moment où le Takrur devient le Fuuta et on note l’assimilation des autres groupes par la langue pour donner les « Haal pulaar ».
Après le peuplement, Ba s’intéresse à la vie du Takrur sous le règne des différentes dynasties qui se sont succédé à sa tête (3ème, 4ème et 5ème parties). Pour le règne des Jaa Ogo, il met l’accent sur l’épanouissement de la métallurgie. De nombreuses sources dont Brigaud, S. A. Sow et H. Gaden, attestent du lien entre les Jaa Ogo et le travail du fer. Ce qui d’ailleurs prouve que cette dynastie est plus ancienne que le IXème siècle et la migration Peule auxquels les associe Delafosse. Ce qui semble ainsi juste, c’est que la dynastie Jaa Ogo daterait des IVème et Vème siècles comme le prouvent les résultats de fouilles archéologiques relatives à la métallurgie sur des sites comme Sincu Baro, proche d’Ogo.
Ainsi, autant les données géographiques que les sources orales attestent des conditions favorables à une métallurgie du fer au Takrur. Si les textes arabes permettent de dater l’exploitation de ces potentialités au XIème siècle, les fouilles archéologiques la font remonter au Vème siècle.
L’association du travail du fer à la dynastie des Jaa Ogo met en valeur la caste des forgerons. Ce qui contraste avec la situation de ce groupe socio-professionnel depuis le XVIème siècle au moins, dans la société Fuutanke, société très hiérarchisée, peut être à l’origine même de ce type d’organisation dans la Sénégambie.
Les Jaa Ogo, venant donc d’une caste désormais perçue comme la plus basse, sont présentés par certaines sources sous des traits négatifs. Il faut voir dans cette présentation dépréciative, l’effet de l’idéologie locale sur les chroniques qui rendent plus compte d’une vision sociétale du groupe auquel appartient le chroniqueur qu’une simple narration de faits. Or, la société porteuse de cette idéologie cachée derrière les chroniques est musulmane et rejette ce qui relève des croyances traditionnelles attachées à la dynastie des Jaa Ogo. Aussi, un chroniqueur comme S. A. Sow relève de l’aristocratie Torodo qui méprise le forgeron. Pour s’en convaincre, il suffit de comparer ces versions des « nobles » à celle de C. M. Kamara qui n’en fait pas partie et qui semble le seul à regarder cette partie de l’histoire du Takrur avec plus de discernement et présente les Jaa Ogo de manière positive, comme des gens francs, sérieux et courageux.
Tout compte fait, le passage de groupe important dans la constitution de la communauté à caste méprisable semble se fonder sur des luttes politiques ou leur échec a changé leur position. Cette hypothèse est de M. Sarr. Il donne l’exemple des Soninkés dont les grandes familles islamisées et liées au commerce à longue distance s’opposent au pouvoir des Tunka à l’idéologie relevant des religions traditionnelles : les grandes familles émigrent en remettant en cause les traditions mettant sur le même pied d’égalité forgerons et nobles.
L’un des enjeux des rapports humains dans la période de règne des Jaa Ogo est le rapport à la terre qui fait naître des conflits entre groupes. En effet, bien que la terre soit un bien inaliénable, un héritage jalousement conservé, elle fait l’objet d’accaparement par les différents chefs qui la distribuent, en fonction des intérêts stratégiques, à ceux qui sont censés consolider leur pouvoir.
La valeur de ces terres est fonction de leur fertilité pour la pratique de l’agriculture. Ainsi, le Walo, plus proche du lit du fleuve Sénégal, fait l’objet d’une grande convoitise, vu le fait, qu’inondé de juillet à novembre, l’agriculture y est facile, le rendement élevé. Par contre, le Jeeri, avec son faible rendement, parce que moins fertile et plus éloigné du lit du fleuve est moins convoité.
Dans un contexte où la terre est aussi importante, il n’est pas étonnant que le titre Jaa que porte la dynastie des Ogo ait un rapport avec la maîtrise de l’espace : terres de culture, terrains de parcours, zones de pêche et sous-sol. Ainsi, Jaa signifierait « maître de terre » et serait comparable aux titres du même genre chez les Mossi, Sereer et Manden. Jaa ogo signifierait également « maître du fer » pour indiquer l’état de forgeron de la dynastie. Dans ce cas, le titre serait comparable à celui des souverains de Ghana : Kayagan ou « maître de l’or ».
L’essence de l’État des Jaa Oga est l’État différentiel où chacun tient un rôle déterminé. De ce fait, l’entité étatique ne peut se réduire à un groupe homogène. Il y faut une différence qui fait que chaque entité a besoin de l’autre ; une différence certes, mais fondée sur la complémentarité et non sur l’exclusion. L’État Jaa Ogo est un État pluriethnique, plurilinguistique où règne la tolérance religieuse : l’État unitaire en Afrique de l’ouest ne serait donc que le fait de l’influence arabo-musulmane et européenne.
Les Manna succèdent aux Jaa Ogo à la tête du Takrur. Le fondateur de cette dynastie serait, selon S. A. Sow, Musa, connu sous le nom de Manna. Il serait venu de Mina au XIème siècle et porterait le patronyme Ba. Mais, d’après Delafosse, la dynastie Manna est d’origine Soninke et War Jaabi en serait le premier ou le deuxième souverain. D’autres sources leur donnent le patronyme de Niakate. Quelle que soit leur identité, les Manna sont connus pour avoir solidifié leur pouvoir par le commerce transsaharien. Leur pouvoir se serait institué autour du XIème siècle dans un contexte où l’or de la région est au centre d’enjeux politiques, idéologiques et économiques entre le pouvoir abbasside et les Fatimides d’Egypte.
Pour ce qui est des liens stratégiques, selon Al Bakri, les Takruri sont présents à la bataille de Tabfarilla aux côtés des Almoravides. Cette présence, contrairement à ceux qui la voient comme circonstancielle, doit être considérée comme permanente, dit Ba, parce qu’elle est le résultat d’une alliance militaire où des soldats noirs, les Takruri, prennent part à des batailles aux côtés des Almoravides. Ba note qu’il ne faut pas se méprendre sur le statut de ces noirs, comme le font certaines sources écrites les rabaissant à la condition d’esclaves enrôlés de force par des négriers arabes pour participer à des batailles importantes comme celle d’Espagne. Même si des esclaves noirs sont engagés dans des campagnes militaires Almoravides, il y figurait des soldats noirs, de condition libre. La réduction des noirs présents dans ces campagnes à la condition d’esclaves résulte sans doute d’un sens commun largement ancré qui renvoie tout le temps l’image du noir à l’esclave alors que cette perception est loin de la réalité dans le fonctionnement de la société almoravide. En témoignent la présence de métis dans l’aristocratie de cette dynastie et le port du voile, qui est un de ces signes distinctifs, par des noirs.
La présence des Almoravides dans le Takrur se fait aussi de façon conflictuelle selon certaines sources. Cette conflictualité se traduit, par exemple, par l’assassinat d’Abu Bakr par un archer Sereer.
La présence Almoravides s’établit également dans des liens matrimoniaux : l’ancêtre des Njaay et fondateur de l’empire Jolof est dit être le fils d’Abu Bakr Ibn Umar, religieux à qui fut donnée Fatima Sall, la fille du Lam Toro, Abrann. Il se peut que Fatimata Sall soit la descente de Lebbi Saal, le Lam Tooro, prince Takruri ayant participé à l’expéditionn de Tabfarilla. Aussi, « Y. Jaaw établit la parenté des Almoravides et des Peuls du Takrur à travers trois générations » (p.216).
En ce qui concerne la vie religieuse au Takrur, on note, selon Ba, la cohabitation entre les religions traditionnelles africaines, conformes à leur idéologie fondée sur l’agriculture et la sédentarité avec reconnaissance d’une divinité suprême (Roog Seen chez les Sereer, par exemple) associée à des divinités jugées plus proches, des esprits intermédiaires (Pangols chez les Sereer) avec l’islam qui y est arrivé au moins avant 1040.
Le facteur qui a favorisé l’implantation de l’islam serait la déstructuration de la société traditionnelle avec l’avènement de la pratique du commerce. En effet, dès lors que la dépendance à la terre d’une bonne partie de la population est rompue, il devient aisé de se détacher des divinités censées assurer la bonne marche de l’agriculture pour adopter l’islam qui est d’abord une religion de commerçants et de nomades. A retenir que l’islam et le paganisme ont cohabité dans le Takrur, souvent dans la paix, même si elle est parfois conflictuelle. L’islamisation de la zone n’est pas uniforme en fonction des régions et des corps professionnels et évolue de façon aléatoire jusqu’au moment de la conversion du chef Waar Jaabi, période considérée comme l’apogée de l’islam au Takrur. Là, les textes écrits rejoignent les sources orales Walof et Fuutanke qui font état d’une conversion d’un Lam Toro, comme mentionné plus haut.
Aux XIème et XIIème siècles, l’islam, pris au plan individuel, fait figure d’un syncrétisme, signe d’une adaptation de la religion de Muhammad aux cultures locales sans que les populations n’abandonnent ainsi leurs civilisations pour adopter entièrement la culture arabo-musulmane. Mais, d’un point de vue politique, l’islam est un instrument de pouvoir qui dicte une subdivision du territoire en deux zones distinctes : une zone des infidèles où il est légitime de mener la guerre sainte (Dar al harb) et une zone d’islam, synonyme de paix (Dar al salam). Ce qui a pour effet le pillage des zones non musulmanes du Takrur dont les populations sont réduites en esclaves et vendues en Afrique du Nord. Cette situation contraste avec l’avant XIème siècle où cohabitaient populations animistes et populations musulmanes non prosélytes et sans assise militaire solide. Cette nouvelle donne cause l’exode de populations animistes vers le sud pour fuir face à une force si fulgurante alliée aux puissants Almoravides.
Enfin, au XIIIème siècle, le pouvoir des Manna prend fin. Il n’existe pas de sources écrites arabes sur cette fin de règne. Mais des sources orales font état d’une chute causée par le despotisme et la déviance de Manna Maxan, dernier de la dynastie dont les exactions et autres errements auraient fini par exaspérer les populations : elles lui auraient alors tendu un piège pour le noyer à l’aide d’une pirogue. Mais, avant même cette chute de Manna Maxan, le pouvoir de la dynastie était largement titubant. En fait foi, l’agitation dans les régions extrêmes orientales et occidentales qui échappent à leur contrôle. On assiste ainsi à la constitution du royaume Walof à l’Ouest et aux velléités d’indépendances de Barisa à l’Est selon Ibn Said.
Dès lors, le Takrur fait les frais de l’expansion de l’empire du Mali comme l’attestent les sources orales et arabes. Le Takrur est placé sous la tutelle des Tonjons, guerriers issus de castes liées aux Keita, souverains du Manding. Ces Tonjons apparaissent, non pas comme une dynastie, mais comme un corps de fonctionnaires au service de l’empereur. Ils constituent également une armée de métier, vivant des contributions imposées aux populations et prennent l’image d’une aristocratie régnant sur le Takrur par la violence.
[1] Une période de début de cette domination n’a pas été donnée.